Bien que le fonctionnement interne des processeurs puisse paraître mystérieux, il est le fruit de décennies d’une ingénierie sophistiquée. Les transistors, composants fondamentaux de chaque microprocesseur, rétrécissent à des dimensions microscopiques, ce qui complexifie leur production de manière exponentielle.
La photolithographie : une technique de précision
La taille incroyablement réduite des transistors rend impossible leur fabrication par des méthodes conventionnelles. Malgré la précision des tours d’usinage et des imprimantes 3D, qui atteignent des précisions micrométriques (environ un trentième de millimètre), ces outils sont inadaptés aux échelles nanométriques nécessaires à la fabrication des puces actuelles.
La photolithographie résout ce problème en éliminant le besoin de déplacer des machines complexes avec une précision extrême. Cette technique utilise la lumière pour graver une image sur la puce, un peu comme un rétroprojecteur, mais avec une réduction de l’image projetée à la précision souhaitée.
L’image est projetée sur une galette de silicium, usinée avec une très grande précision dans des laboratoires où tout est contrôlé. La moindre poussière sur la galette pourrait entraîner des pertes financières considérables. La galette est recouverte d’un matériau photosensible, le photorésist, qui réagit à la lumière. Une fois exposé, le photorésist est retiré, laissant apparaître une gravure du CPU. Cette gravure peut être remplie de cuivre ou dopée pour créer des transistors. Ce processus est répété plusieurs fois, construisant le processeur couche par couche, à la manière d’une imprimante 3D.
Les défis de la photolithographie à l’échelle nanométrique

La miniaturisation des transistors ne suffit pas si ces derniers ne fonctionnent pas correctement. La technologie à l’échelle nanométrique se heurte à des problèmes physiques majeurs. Les transistors doivent bloquer le flux d’électricité lorsqu’ils sont éteints. Cependant, à ces dimensions, les électrons peuvent traverser les barrières isolantes par un phénomène appelé effet tunnel quantique, un défi majeur pour les ingénieurs en silicium.
Les défauts sont un autre problème. Même la photolithographie a ses limites en termes de précision. On peut comparer cela à une image floue projetée par un projecteur. Plus l’image est agrandie ou réduite, plus elle perd en netteté. Les fonderies cherchent à atténuer cet effet en utilisant la lumière ultraviolette extrême (EUV), une longueur d’onde beaucoup plus courte que celle perceptible par l’œil humain, obtenue à l’aide de lasers dans une chambre à vide. Toutefois, le problème persiste à mesure que les dimensions diminuent.
Les défauts peuvent parfois être gérés grâce à un processus appelé « binning » : si un défaut affecte un cœur de processeur, ce cœur est désactivé et la puce est vendue comme un modèle moins performant. La plupart des gammes de processeurs sont fabriquées à partir du même modèle, mais avec des cœurs désactivés et vendus à un prix inférieur. Si un défaut affecte la mémoire cache ou un autre composant essentiel, la puce doit être mise au rebut, entraînant une baisse du rendement et une augmentation des coûts. Les nœuds de fabrication les plus récents, tels que 7 nm et 10 nm, ont des taux de défauts plus élevés et sont donc plus chers.
Le conditionnement final du processeur
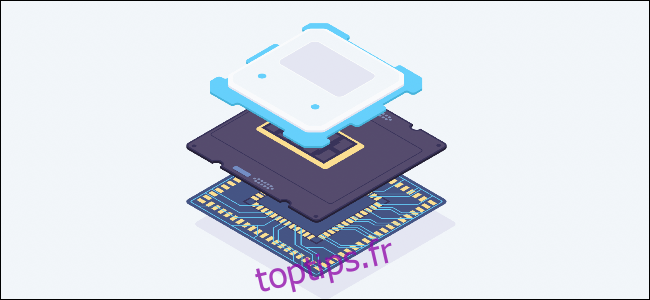
Le conditionnement d’un processeur pour le grand public ne se limite pas à le mettre dans une boîte avec du polystyrène. Une fois le processeur fabriqué, il est inutilisable s’il ne peut pas être connecté au reste du système. Le processus de « conditionnement » consiste à fixer la fragile puce de silicium sur le circuit imprimé que la plupart des gens considèrent comme le « processeur ».
Ce processus requiert une grande précision, bien que moindre que les étapes précédentes. La puce du CPU est montée sur une carte de silicium, et les connexions électriques sont réalisées avec les broches qui se connectent à la carte mère. Les processeurs modernes peuvent avoir des milliers de broches, comme le processeur haut de gamme AMD Threadripper, qui en compte 4094.
Comme le processeur génère beaucoup de chaleur et doit également être protégé, un « dissipateur de chaleur intégré » est monté sur le dessus. Il entre en contact avec la puce et transfère la chaleur vers un système de refroidissement. Pour les passionnés, la pâte thermique utilisée pour cette connexion n’est parfois pas suffisante, ce qui pousse certains à décoiffer leurs processeurs pour appliquer une solution de meilleure qualité.
Une fois le processeur assemblé, il est emballé dans des boîtes, prêt à être mis en rayon et installé dans votre futur ordinateur. Vu la complexité de sa fabrication, il est étonnant que la plupart des processeurs ne coûtent que quelques centaines de dollars.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la fabrication des processeurs, vous pouvez consulter les explications de Wikichip sur les procédés de lithographie et les microarchitectures.